Dialogue sur la souveraineté
4 Août 2016
Un livre de dialogue avec le théologien et philosophe du politique, Bernard Bourdin[1], se prépare avec la complicité active de Bertrand Renouvin. J’ai écrit dans Souveraineté, démocratie, laïcité[2] : « L’ordre démocratique se veut et se définit comme une conception à la fois matérialiste (au sens où elle n’implique pour sa définition ou sa compréhension aucune référence religieuse et n’ont donc pas contradictoire avec aucune des religions professées par les citoyens) et réaliste de l’organisation des sociétés. ». Dans son ouvrage Le christianisme et la question du théologico-politique[3], Bernard Bourdin écrit quant à lui que « transcendance et histoire sont le secret de l’institution du politique ». Ces deux citations permettent d’amorcer un débat d’ampleur considérable. Ce livre devrait être publié cet hiver aux éditions du Cerf. Deux dialogues de 3h chaque ont été enregistré et seront disponibles en vidéo. Je soumets à la sagacité de mes lecteurs le début de l’exposé de mes positions. Et à ceux qui pourraient s’étonner de ce dialogue je ne peux que citer Louis Aragon dans la Rose et le Réseda, poème écrit en 1943 :
« Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat » [4].
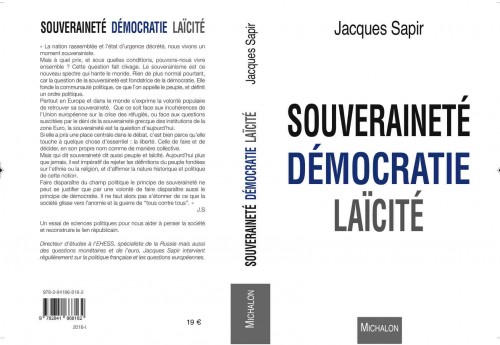
La notion de souveraineté doit être dégagée des débats actuels – qui ont bien entendu leur importance – mais qui peuvent en obscurcir les fondamentaux. Il faut pour cela remonter à la préhistoire de l’homme si l’on veut en comprendre l’origine. Il y a souveraineté dès qu’il y a société. Mais à partir de quand pouvons-nous parler de société ?
Aux origines de l’homme
Une partie de l’éthologie considère qu’il y a des sociétés avant l’homme[5]. Si c’est bien le cas, la souveraineté remonte à un stade effectivement archaïque, qui est antérieur, non pas à notre conscience, mais à notre manière contemporaine de formuler notre conscience. Elle serait antérieure au langage articulé. On le voit, la notion de souveraineté renvoie au plus ancien des êtres pensants. L’analyse des primates évolués, nos proches cousins comme les Chimpanzés et les Bonobos montre que la société, avec ses hiérarchies, ses procédures d’inclusions et d’exclusions, de conflit mais aussi de réconciliation, précède l’humanité au lieu d’en découler[6]. L’homme s’est ainsi progressivement humanisé de part la vie en société[7].
Se pose alors un second problème : que se passe-t-il quand deux sociétés de pré-humains ou d’humains se rencontrent ? Si nous avons une seule société existant sur un espace donné, cette société n’a pas à se poser le problème de sa souveraineté parce que, d’une certaine manière, ce groupe ne possède rien et possède tout. Mais quand ce groupe rentre en contact avec d’autres groupes, le problème va se poser. Or nous savons que ces contacts apparaissent immédiatement, sans pour autant être permanents. Nous savons aussi que tout groupe procède à des expulsions d’individus comme forme de punition – ce qui veut bien dire l’importance du groupe pour la survie. Et nous avons enfin que dans le contact entre les clans, les tribus, il s’agit de savoir ce qui est aux uns et ce qui est aux autres. Il y a de la souveraineté quand il y a de l’altérité et nous voyons apparaître un principe de communauté et un principe de distinction entre différentes communautés. On peut même dire que la souveraineté découle de l’altérité que c’est cette dernière qui la rend nécessaire. De ce point de vue, quand j’entends des collègues qui veulent me faire une critique de la souveraineté en me disant que celle-ci implique l’homogénéité, j’avoue être sidéré par ce contre-sens. Si il y a ce besoin de souveraineté, c’est justement parce que nous devons vivre avec nos différences. Si nous étions une communauté d’individus entièrement homogènes, la souveraineté ne serait pas nécessaire car nous penserions spontanément les mêmes solutions aux problèmes que nous rencontrons. Dès lors, l’action de chaque individu serait la même que l’action collective, et le conflit aurait disparu. La nécessité de trouver une solution, ne serait-ce que provisoire, au conflit n’existerait plus. Il n’y aurait donc plus ni institution ni formes de médiation. Dans cet univers on peut effectivement se défaire du concept de souveraineté. Mais on comprend immédiatement que cet univers est illusoire.
La question du pouvoir, entre incarnation et dépersonnalisation
Dès lors se pose une question fondamentale. Dans toute société, se pose en effet la question de savoir qui commande, que ce soit à l’instant donné ou de manière permanente, et surtout au nom de quoi commande-t-il. Commande-t-il en son nom personnel, pour son « bon plaisir » ou bien est-il le délégataire de quelque chose qui le dépasse ? C’est sur ce point que va se fonder le souci de transcendance : le pouvoir de celui qui l’exerce est-il seulement lié à la personnalité de celui qui l’exerce ?
Cela s’observe dans des microsociétés, qui se défont d’ailleurs lorsque le détenteur du pouvoir disparaît. D’où la nécessité de détacher le pouvoir de celui qui l’exerce. La dépersonnalisation du pouvoir est une nécessité de son plein exercice. Mais, dans le même temps, les hommes ont toujours eu besoin d’identifier le détenteur du pouvoir. La fonction, et ce d’autant plus qu’elle est dépersonnalisée, doit être incarnée. D’où cette contradiction qui fait qu’une excessive personnalisation tout comme une dépersonnalisation absolue rendent l’une et l’autre impossible le plein exercice du pouvoir et confrontent les sociétés au spectre de leur dissolution. Il faut donc réconcilier ces deux pôles, ce qui conduit à la solution où le pouvoir d’un (ou d’une) ne devient possible que par la délégation par tous de cette faculté à exercer le pouvoir ; et dans cette délégation nous avons la légitimité. Mais, le fait que « tous », et que ce tous ne concerne que quelques dizaines ou des millions d’individus, puissent déléguer implique que ce « tous » est souverain ; il détient la souveraineté.
L’exemple romain
De ce point de vue, il est important de revenir à l’exemple romain, de la Rome républicaine comme de la Rome impériale. La structure du pouvoir législatif et judiciaire y est complexe. S’y articulent tant des formes populaires, les Comices centuriates et tributes, le concile de la Plèbe, que des formes aristocratiques comme le Sénat[8]. La complexité de ces formes a tendu à en obscurcir la logique. Cependant, il convient de distinguer l’exercice de la souveraineté, qui se fait dans des articulations susceptibles d’évoluer, de l’origine de cette souveraineté. Mario Bretone, dans un ouvrage de référence qui a été traduit de l’italien récemment, cite le principe : « la Loi est le décret général du peuple ou de la plèbe sur la demande d’un magistrat »[9]. On retrouve cette idée sous l’empire. Dans la loi d’investiture de Vespasien (69-79 de notre ère), la fameuse « Lex de imperio Vespasiani », la ratification des actes de l’empereur avant son investiture formelle est dite « comme si tout avait été accompli au nom du peuple »[10]. On perçoit que l’origine de la souveraineté réside dans le peuple, même si ce dernier en a délégué l’exercice à l’empereur. Ainsi, le principe de souveraineté populaire était déjà connu il y a 2000 ans. Voilà qui fait réfléchir, ou qui devrait le faire, et en particulier ceux qui prétendent qu’il s’agit d’une invention de la Révolution française !
A cela, on peut assurément opposer la présence dans cette loi d’investiture d’une clause discrétionnaire, qui autorise l’empereur à agir « hors des lois » dans l’intérêt et pour la majesté de l’Etat. Mais on peut aussi considérer cela comme une première formulation de l’état d’exception. D’ailleurs Paolo Frezza parle de la « potestas nouvelle et extraordinaire » de l’empereur[11]. Bretone, avec d’autres, lui oppose cependant le sens profond de cette clause discrétionnaire, qui peut être l’origine d’un pouvoir autocratique[12], et conclut : « la subordination du souverain à l’ordre légal est volontaire, seule sa ‘majesté’ pouvant lui faire ressentir comme une obligation un tel choix, qui demeure libre »[13]. De fait, l’empereur réunit dans ses mains tant la potestas que l’auctoritas. Il s’y ajoute l’imperium, que détenaient avant lui les magistrats républicains.
On pourrait croire que ceci clôt le débat car une subordination volontaire n’est pas une subordination. Mais, la phrase de Bretone ouvre une piste que cet auteur n’explore pas. Quand il écrit, « seule sa ‘majesté’ pouvant lui faire ressentir comme une obligation» cela peut signifier qu’un empereur qui violerait les lois existantes pour son seul « bon plaisir » et non dans l’intérêt de l’Etat, perdrait alors sa « majesté » qui accompagne l’imperium. Dans ce cas son assassinat deviendrait licite car le « dictateur » se serait mué en « tyran ». Et l’on sait que nombre d’empereurs sont mort assassinés, ou ont été contraints de se suicider. On pense à Néron ou à Caligula.
Il est ici intéressant de constater la persistance du vocabulaire et des catégories républicaines au sein de l’empire[14]. C’est pourquoi je pense que même sous l’empire, c’est bien le peuple qui détient la souveraineté. L’empereur bénéficie d’une délégation, certes extensive, mais qui ne vaut pas cession. Il est un dictateur au sens romain du terme, qui peut s’affranchir de la légalité si nécessaire pour le bien de l’Etat et du « peuple » dans ce que l’on appelle des cas « extremus necesitatis »[15], mais il ne dispose pas de ce pouvoir de manière « libre » comme le dit Bretone. Il doit en justifier l’usage, quitte à se faire assassiner. On est en réalité face à une problématique très moderne, celle de l’état d’exception[16]. Il est aussi vrai que l’on aura une dérive vers l’autocratie dans l’empire tardif, sous Dioclétien et encore plus avec Constantin[17]. Le poids de la religion chrétienne est à évaluer ici, car le monothéisme peut être congruent à l’autocratie. Mais, il faut aussi dire que cette évolution a commencée avant la conversion de Constantin.
Pouvoir et transcendance
Revenons maintenant au problème de la transcendance. On peut aussi en fournir une explication purement fonctionnelle. Il y a en effet une manière de comprendre ce problème à partir d’un nécessité de justification : à partir du moment où le pouvoir peut aller jusqu’à la mise à mort d’autrui, jusqu’à exiger le sacrifice d’autrui dans le cas d’un conflit de territoire, qu’est-ce qui donne le droit à un homme d’exiger d’un autre homme qu’il mette à mort un ennemi au péril de sa propre vie ? On comprend qu’il y ait eu dès lors le besoin, à un moment donné, de faire référence à une dimension surnaturelle. La transcendance apparaît nécessaire à la légitimation d’actes terribles. Il faut alors invoquer des puissances surnaturelles ou s’en réclamer. On comprend la présence de la religion dès le début des législations. De fait, à Rome, les premiers juristes furent les pontifes, soit une magistrature religieuse. En même temps, ces « prêtres-juristes » avaient une fonction technique d’expertise[18]. Le droit s’est ainsi émancipé de la tutelle religieuse pour devenir, à Rome, une activité autonome.
Mais je pense que ce besoin de légitimation et de justification n’est pas permanent et nous pouvons aussi avoir une autre lecture qui consiste à dire ceci : le pouvoir distinct de celui qui l’exerce, le pouvoir d’exiger des êtres humains des actes qui ne sont pas naturels comme la mise à mort, trouve son fondement dans le bien commun – autrement dit, la survie du groupe. Cela nécessite une construction longue et pénible de cette notion de bien commun. Pendant cette construction, le surnaturel a offert un raccourci pour définir ce bien commun. Il est donc nécessaire à la fois de comprendre les raisons d’être de ce raccourci, de les admettre comme des contraintes matérielles, et en même temps de ne pas en être dupe, de ne pas les fétichiser. Mais, cela pose un autre problème. Nous vivons dans une société qui, parce qu’elle est aliénée produit constamment une fétichisation du monde. Pouvons-nous alors, tout en étant conscient de la nécessité de ne pas fétichiser, ne pas le faire contre nous ?
Quant à la transcendance j’admets tout à fait que des croyants tiennent à cette idée et cohabitent paisiblement avec des incroyants qui estiment quant à eux que cette question de la transcendance renvoie à des raccourcis qui ont été nécessaires à un moment donné de l’histoire de l’humanité. Les incroyants, parmi lesquels je me range, doivent reconnaître ce moment de l’histoire et doivent en admettre la nécessité, même s’ils ne croient pas en une quelconque puissance surnaturelle. C’est cette compréhension d’une nécessité objective du raccourci religieux à un moment historique donné qui définit le mieux ce que j’appelle une conception matérialiste de la politique, et donc une définition des concepts principaux, la souveraineté, la légitimité, qui ne soit pas fondée sur une croyance religieuse. Quand je dis que l’ordre démocratique, part d’une conception matérialiste au sens où sa définition n’implique aucune référence religieuse, cela ne veut pas dire que j’exclus des possibles définitions religieuses. Je sais que le besoin de trouver des raccourcis peut impliquer, dans certaines situations le détour par une explication qui soit de l’ordre du religieux. Je sais aussi que des définitions religieuses des concepts utilisés dans l’ordre démocratique sont donc possibles, et même qu’elles sont nécessaires aux croyants. Mais, je dis qu’il y a possibilité de définir l’ordre démocratique uniquement de manière matérialiste, en mettant de côté toute explication religieuse, ce qui en définitive le rend compatible avec toutes les religions puisque aucune n’est en réalité nécessaire à sa définition. Cette définition n’est donc pas exclusive : c’est une définition de base. Si un croyant veut apporter sa définition et son interprétation, du moment qu’il respecte les principes de l’ordre démocratique, il est évidemment libre de le faire.
L’individu et la société
Deux problèmes se posent. Le premier : est-ce que l’individu peut exister sans liens avec d’autres individus ? C’est cela une des définitions les plus communes de l’état de nature, qui peut cependant être aussi pris comme une métaphore comme nous le verrons tout à l’heure, mais qui n’existe pas réellement. Les premiers grands primates pré-humains fonctionnaient déjà en société parce que l’une des caractéristiques des grands primates – et de l’homme – c’est qu’ils sont facilement adaptables mais qu’ils ne sont supérieurs en rien, sauf l’intellect. Les grands primates et les humains n’auraient donc pas pu survivre s’ils avaient été isolés[19].
On ne peut donc pas penser l’individu puis la société, sur le modèle des briques et du mur, comme le font certains économistes, ou sociologues : l’individu fait d’emblée partie de la société. Il faut donc faire une critique radicale des « Robinsonnades » qui posent toutes un homme isolé. Il est stupéfiant que Böhm-Bawerk, et avec lui l’école marginaliste en économie, ait usé de cette métaphore. Et l’on a tendance à oublier un peu trop souvent que Robinson Crusoë n’est pas une œuvre scientifique mais un « roman d’éducation » écrit par un des grands pamphlétaires religieux anglais, Daniel Defoe. L’idée religieuse est d’ailleurs très présente dans l’ouvrage. Si Robinson est devenu le paradigme de départ de la littérature économique marginaliste comme de certains théoriciens du politique[20], cela pose en vérité un véritable problème de logique.
Si Robinson ne retourne pas à l’animalité, c’est qu’il envisage toujours sa position dans la perspective de son intégration à une collectivité, que ce soit son retour possible à la civilisation ou sa position vis-à-vis de la communauté des croyants à laquelle il appartient et qu’il espère rejoindre après son trépas. Robinson, bien avant que Vendredi ne fasse son apparition, n’est jamais seul, et l’importance de sa Bible le montre bien. C’est d’ailleurs, symboliquement, la première chose qu’il sauve du naufrage. On a là un bel exemple d’une aporie religieuse dans les sciences sociales. Or, la souveraineté doit se penser dans les termes des sciences sociales, ce qui n’exclut pas que l’on puisse aussi en faire une lecture religieuse.
Pour en finir avec l’état de nature
Quant à l’état de nature, on peut aussi le comprendre comme une construction logique, ou plus précisément un artifice rhétorique, et non pas une réalité historique. A un moment donné, on a besoin d’émettre une hypothèse : admettons qu’il y ait un individu hors de toute société, comment se comporterait-il ? On sait très bien que ce n’est jamais, et cela n’a jamais été, le cas mais logiquement cela peut avoir un usage pédagogique, que ce soit pour raisonner par l’absurde ou que ce soit pour essayer de démontrer quelque chose dans l’ordre des comportements. Le problème, c’est que cette définition de l’état de nature comme simple artifice logique a été prise trop au sérieux ! Le fait est que l’état de nature est un artifice extrêmement puissant pour mettre à jour les structures de domination qui existaient aux 17ème et 18ème siècle. On se souvient de Jean-Jacques Rousseau qui écrit dans Du Contrat Social : l’homme est né libre et partout il est dans les fers. La capacité pédagogique, et même propagandiste, de l’état de nature est alors à son summum ! Il faut reconnaître ce rôle politique dans l’histoire des idées mais cela ne veut pas dire qu’il faut y croire ou plus précisément que nous devons croire en la réalité de cet artifice. Ajoutons que le raisonnement sur l’état de nature est identique à celui des économistes néo-classiques sur l’individu. Supposer une économie avant même qu’existe une société n’a pas de sens, du moins pour une analyse historique. On peut admettre qu’un économiste veuille construire un monde imaginaire et en faire les lois ; grand bien lui fasse. Mais qu’il ne vienne pas nous expliquer que ce monde imaginaire est le monde réel !
Revenons maintenant sur les sociétés humaines et pré-humaines. Tous les travaux éthologiques sur les primates montrent qu’il y a des structures hiérarchiques très fortes dans les groupes qu’ils forment. Ces groupes de primates font évoluer leurs structures sur de très longues périodes alors que l’homme se caractérise par le fait qu’il peut faire évoluer ces structures plusieurs fois dans le temps d’une existence individuelle. Il y a là un vrai changement qualitatif, qui engendre à son tour un rapport spécifique au temps. Ce rapport au temps est probablement lié à l’invention de la parole – pas du langage, car les pré-humains ont un langage par le biais des signes mais il n’est pas articulé. Or le langage articulé a la capacité de véhiculer rapidement non seulement beaucoup plus d’informations que le langage des signes mais surtout de véhiculer des informations abstraites – des concepts. Il y a bien ici une spécificité de l’être humain et des sociétés humaines. Mais, cette spécificité se concentre sur la conscience de l’historicité des sociétés. Or, cette historicité se traduit aussi par l’entassement des institutions, c’est-à-dire de la construction sociale. Ces institutions sont, en premier lieu, des espaces de souveraineté qui se donnent les hommes. Nous y voilà, notre conception de la nature, et ce quelle que soit la définition que l’on utilise, est toujours sociale.
Quant aux institutions, elles ne sont pas produites par des gens qui sont dans des situations d’égalité. Cela signifie qu’il y a des conflits qui donnent naissance aux institutions. Pour pouvoir aboutir à ce compromis nécessaire qui va faire l’institution, il faut que le groupe soit libre. Il y a un lien essentiel entre la souveraineté – et la capacité à faire des institutions – et la liberté. Un groupe privé de liberté ne peut pas penser la production d’institutions, il ne peut plus penser la liberté collective et il ne peut plus penser la liberté individuelle. C’est pour cela que la question de la souveraineté est absolument centrale. Nous aurons l’occasion d’y revenir mais je dis tout de suite que la légitimité a besoin de la souveraineté pour se construire : ainsi, la souveraineté préexiste logiquement à la légitimité.
Notes
[1] Bourdin B., La Médiation chrétienne, Paris, le Cerf, 2009. Bernard Bourdin est Dominicain et enseigne à l’Institut catholique de Paris
[2] Sapir J., Souveraineté, démocratie, laïcité, Paris, Ed. Michalon, 2016.
[3] Bourdin B., Le christianisme et la question du théologico-politique , Paris, le Cerf, 2015.
[4] Aragon, L., « La Rose et le Réséda », (À Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Guy Môquet et Gilbert Dru), mars 1943 (repris dans La Diane française, 1944).
[5] F. De Wall et F. Lanting, Bonobos, le bonheur d’être singe, Fayard, Paris, 1999.
[6] Godelier, M., « Quelles cultures pour quels primates, définition faible ou définition forte de la culture ? », in Ducros A., Ducros J. & F. Joulian, La culture est-elle naturelle ? Histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, 1998, p. 217-222.
[7] Picq P., « L’humain à l’aube de l’humanité » in Serres, M. P. Picq, J-D. Vincent, Qu’est-ce que l’Humain, Pari, Pommier, 2010, p. 64.
[8] Voire Nicollet C., « Polybe et la ‘constitution’ de Rome » in C. Nicollet (dir), Demokratia et Aritokratia. A propos de Caius Gracchus : mots grecs et réalités romaines, Paris, Presse de la Sorbonne, 1983.
[9] Bretone M., Histoire du droit romain, Paris, Delga, 2016, p. 51.
[10] Idem, p. 215.
[11] Frezza P., Corso di storia del diritto romano, Rome, Laterza, p. 440.
[12] Brunt P.A., « Lex de imperio Vespasiani » in The Journal of Roman Studies, vol. 67, 1977, pp. 95-116.
[13] Bretone M., Histoire du droit romain, op.cit., p.216.
[14] Bretone M., Histoire du droit romain, op.cit., p.215. Brunt P.A., « Princeps et Equites », in The Journal of Roman Studies, vol 73, 1983, pp. 42-75.
[15] Schmitt C., Théologie Politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988; édition originelle en allemand 1922, pp. 8-10
[16] Saint-Bonnet F., L’état d’exception, Paris, PUF, 2001.
[17] Jones A.H.M., The Later Roman Empire 284-602, t. I-III, Oxford University Press, Oxford, 1964.
[18] Bretone M., Histoire du droit romain, op.cit., p. 103-105.
[19] M. Godelier, Métamorphoses de la Parenté, Paris, Fayard, 2004.
[20] Grapard U. et Hewitson G., Robinson Crusoe’s Economic Man: A Construction and Deconstruction , Londres, Routledge, 2012.


